Commandant Brenot
Extraits d'un
document réalisé par Bruno Le Marcis à partir d’un fonds d’archives
personnelles
La fin de son service militaire
"
La débâcle sous les bombes
Le 9 juin au matin, les hommes du Bataillon de l’Air 116 sont évacués
vers Oloron-Sainte-Marie sur ordre de son Commandant, le Colonel
Plousey. Les péripéties ne manquent pas : le ravitaillement fait défaut,
l’essence est comptée, les pannes mécaniques se multiplient, plusieurs
véhicules doivent être abandonnés.
"
Enfin, Oloron
Le B.A. 116 atteint les Pyrénées, via Chartres (27), Méhers (41),
Argenton-sur-Creuse (36), Aubazine (19), Sainte-Livrade-sur-Lot (47) et
Saint-Justin (32).
À Chémery,
Marcel Brenot confie
à son fils aîné, qui vient de fêter ses 18 ans mais n’a pas encore décroché
son permis de conduire, une mission de confiance : le rejoindre au plus
vite au volant de la Renault Vivaquatre familiale (surnommée Adélaïde eu
égard, sans doute, à son profil assez peu sportif). Un ami l’accompagne.
Le voyage tourne à l’épopée des J3. La jonction se fait le 17 juin à
Argenton-sur-Creuse où le B.A. 116 stationne. Le 19 juin la route est
bloquée par un intense bombardement de l’aviation italienne.
Le lendemain, le convoi s’ébranle de nouveau, les jeunes suivent à
distance.
À Eguzon (36), les chasseurs italiens reviennent. Cette fois, leur cible
est une centrale électrique. Ils font mouche à trois reprises. La
Vivaquatre, désormais
assurée
d’un ravitaillement en essence lui permettant d’atteindre les Pyrénées
sans encombre, prend le chemin des écoliers et met le cap sur Cahors
(46) pour y déposer des soldats orphelins de leur formation pris au bord
de la route.
Dix-sept jours après son départ, le 25 juin au soir, le convoi fait son
entrée à Oloron-Sainte-Marie sous une pluie battante. Les officiers du
B.A. 116 s’installent dans le provisoire, en attente d’un ordre de
marche vers une nouvelle affectation. Première nécessité,
le mess des officiers investit une vieille maison à
colombages, près
du pont Sainte-Marie, en surplomb du gave d’Aspe. Le Commandant en
second qu’est Marcel Brenot installe
ses pénates dans une vaste propriété appartenant à la famille Bordeu.
Le fils, arrivé à bon port, est prestement dirigé avec quelques jeunes
gens du cru vers le Lycée de Pau — il n’y a pas de guerre qui vaille
l’abandon des études ! —, où il peut s’inscrire
de justesse
à la session du baccalauréat organisée le 12 juillet. Brillant, il
rejoindra la corniche Turenne à Toulouse, parachèvera sa formation à
l’École militaire de la Garde (Au
sein de l’école
militaire de la Garde, que commande le Général
Perré,
en mai 1944. Il entre
à
St Cyr le 3 janvier 1945.), à Cusset (03), et effectuera un bref
séjour au S.T.O. Au sein de la Division d’Auvergne,
il participera ensuite
à tous les combats qui précéderont la Libération, dans l’Armée de
Lattre. Il se distinguera, du côté de Belfort.
"
Continuer
à servir "
Le courrier reprend petit à petit. Désormais, la liaison est rétablie
avec le Loir-et-Cher. Mi-juillet 1940, Marcel Brenot écrit brièvement à
son épouse : « Nous devons partir sous 15 j. 3 sem. en direction de
Marseille. Je ne peux rien te dire de plus. »
Il précise:
« Je suis Commandant de Place, quelque chose comme le Préfet de police
de la localité (…). »
Le 14 juillet à Oloron, le B.A. 116 au grand complet défile au Square
des Poilus (aujourd’hui place De Gaulle), au pied du monument aux morts
de la Grande Guerre 14-18, une imposante colonne en granit de Bretagne
située face à la Poste. Le ban et l’arrière-ban sont au garde-à-vous. Le
Sous-Préfet et le député, maire d’Oloron, Jean Mendiondou, sont
présents. Lors de la cérémonie des couleurs, le Colonel Plousey fait don
à la ville du pavillon du B.A. 116
« (…) crasseux des fumées des
incendies allumés par le bombardement (…) pour qu’il flotte toujours en
haut de ce mât. »
Au Commandant Brenot revient
l’honneur d’épingler en son centre l’insigne du
bataillon.
Une douzaine de jours plus tard, le B.A. 116 plie bagage vers d’autres
horizons. Un convoi de véhicules (camions-citernes, camions bâchés et
Citroën C3) servis par une dizaine d’officiers de l’Armée de l’Air
prend la route fin juillet. Le 26, les derniers hommes en charge de
l’entrepôt 303 du B.A. 116 rallient Lyon en train.
Le 29 juillet 1940, un courrier du Secrétariat d’État à l’Aviation fait
savoir au Général commandant la 38e Région
Aérienne
à
Pau, que
« le Commandant de Réserve BRENOT du Bataillon de l’Air 116 est
autorisé, sur sa demande, à
continuer
à servir en situation d’activité, jusqu’à l’expiration de son contrat en
cours (1er
août
1941). »
Problèmes
budgétaires ?
Marcel Brenot n’ira pas jusqu’à ce terme. Vichy le radie du corps du
contrôle auquel il appartient.
Le 1er septembre 1940, il bénéficie d’une permission d’un mois pour se
rendre à Saint-Julien-de-Chédon (41) avec sa voiture personnelle. Ce
déplacement est-il en lien avec la nomination imminente de Marcel Brenot
à Gurs ? Sa permission l’autorise à se rendre également à Saint-Aignan,
point de passage contrôlé de la ligne de démarcation. La mémoire
familiale rapporte que son épouse et ses deux filles jumelles ont passé
la ligne, camouflées dans le camion d’un fabricant de chaussures,
habitué des routes de la région qu’il arpente pour approvisionner
magasins et marchés. Les Allemands, habitués à ses allées et venues, ne
contrôlent plus le camion depuis longtemps.
Il devient Fonctionnaire
- Chef
du 182e G.T.E. à Gurs et du 526e à Izeste (1940-1943)
Le Commandant Alcide, Pierre, Marcel Brenot est affecté au 182e Groupe de Travailleurs Etrangers (GTE), comme Chef de groupe, le 9 novembre 1940, en remplacement de M. Hubert Cosse. L’avis de nomination et le courrier qui l’accompagne sont signés par René Belin, Secrétaire d’État à la Production industrielle et au Travail.
Tout porte à penser que Marcel Brenot a choisi l’opportunité de cette permission pour aller attendre les siens de l’autre côté du Cher, sur la rive gauche, et les ramener avec lui. Le 2 octobre 1940, il est démobilisé à Pau. Un mois après, finie la carrière militaire, le 9 novembre, il devient simple fonctionnaire.
( Pour en savoir plus sur le compagnie de travailleurs étrangers CTE et GTE )
"Spécialiste du bois"
À la tête, à ce jour, du 182e G.T.E., il déploie
tous ses efforts pour gérer les
travailleurs étrangers — pour la plupart des Républicains espagnols,
qu’il
place, par des contrats de travail, dans les usines et les entreprises
de la
région.
Beaucoup d’entre eux sont employés aux travaux forestiers. Un domaine
que connaît bien Marcel Brenot. C’est un spécialiste du bois : les
essences n’ont pas de secret pour lui. Il sait d’un coup d’œil sûr cuber un fût
jusqu’au houppier lorsqu’il n’a pas avec lui son grand compas de
forestier en chêne.
Pénurie d’essence oblige, camions et automobiles sont équipés de gazogènes
qu’il
faut alimenter en charbon de bois. Le travail ne manque donc pas dans le
secteur : abattage, coupe, carbonisation et débardage des grumes de bois
nobles vers les scieries et les industries de transformation de la
région.

La gestion des travailleurs étrangers n’est pas toujours de tout repos.
Il faut savoir canaliser quelques personnalités trop marquées, voire les
écarter pour préserver coûte que coûte
le moral des troupes, garant d’un bon entrain… et de la productivité
qu’en attendent les employeurs.
Tous les
groupes de T.E. ne
se ressemblent pas, tant s’en faut. Et certains « petits chefs », sans
doute moins imprégnés de la droiture militaire qui guide encore Marcel
Brenot, peuvent se montrer injustes et brutaux :
tout ce qu’il exècre.
Autour du camp de Gurs se développe sporadiquement un marché aussi noir
que parallèle, alimenté par des travailleurs en quête d’un pécule, condition
sine qua non
pour espérer pouvoir se faire la belle. Gare aux vrais voyous qui
abusent de la situation ! À Pau, le tribunal, auquel le Préfet réclame
« des mesures très sévères », tourne à
plein régime.
" Un tempérament d’animateur "
La relative liberté
de mouvement dont jouissent, hors le camp, les hommes
du 182e G.T.E.
susciterait-elle des jalousies ? Marcel Brenot prend soin de recueillir,
des témoignages d’employeurs — parfois très flatteurs (trop ?) —
attestant des qualités morales de ses travailleurs placés et, au
passage, de son efficacité personnelle. Un peu de publicité sur son
œuvre de remise en ordre du 182e G.T.E. ne peut nuire à l’ego.
Parmi les travailleurs espagnols, quelques « meneurs » ont pu tenter de
déstabiliser le groupe en incitant leurs compatriotes à lever le pied.
Une forme de résistance passive face à des employeurs rudes à la tâche,
notamment dans le monde agricole, et parfois âpres au gain. Peu enclins,
quoi qu’il en soit, à respecter les sacro-saintes brisures pour cause de
sieste, comme on a l’habitude de les pratiquer
« tras los montes »,
lorsque s’installe le cagnard.
Marcel Brenot y met bon ordre en réorganisant le groupe, comme il
sait le faire : sur le mode militaire.
Le précédent « patron » de Marcel Brenot, le Colonel Plousey, le porte
en très haute estime. Le 25 mai 1940, il note, prémonitoire :
« Officier remarquable par
l’ensemble de ses qualités. Témoigne d’un allant exceptionnel. Brillante
activité tant physique qu’intellectuel (sic). Caractère ardent. Très
apte à exercer le commandement d’un bataillon dont il saura faire en peu
de temps, grâce à
son tempérament
d’animateur, une unité d’élite »…
Acte I, redonner de la tenue aux hommes en organisant autant que faire
se peut un semblant d’hétérogénéité dans les tenues. Chemises avec
poches à rabat, culottes de cavalerie et bérets pour l’encadrement ;
des ponchos taillés dans des couvertures font office de
cache-misère pour le reste de la troupe.
" L’emblème, le fanion et l’hymne "
Le 182e
G.T.E. a incorporé,
depuis leur arrivée au camp de Gurs en 1940, un certain nombre
d’Allemands expulsés du Pays de Bade pour cause d’antinazisme notoire,
juifs pour la plupart. Dans leurs rangs de ces désormais apatrides dont
certains réussiront à émigrer, principalement aux États-Unis, figurent
de nombreux intellectuels, écrivains, acteurs, musiciens, peintres,
dessinateurs, plasticiens… des sportifs aussi. Une équipe de football
— maillot bleu (?), short blanc
et chaussettes à bandes blanches — se produit au stade d’Oloron.
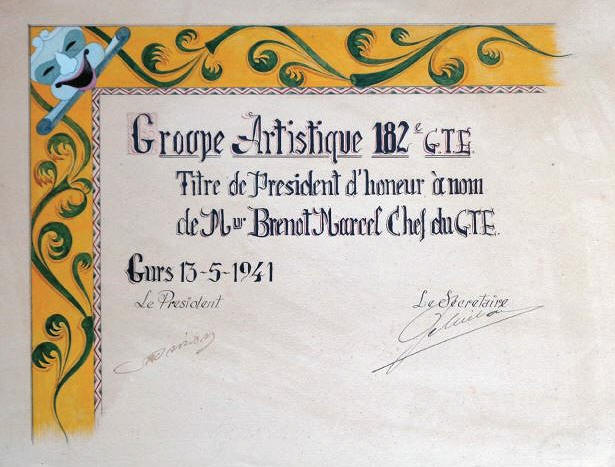
En
« mécène » intéressé, il commande aux artistes la création d’un insigne
et d’un pavillon pour le G.T.E.. L’histoire n’a pas retenu le nom des
graphistes, qui ont choisi l’edelweiss pour emblème — les béarnais
l’appellent « imortèla » — sur fond bleu-blanc-rouge,
ni celui de l’inventeur du fanion, qui — clin d’œil (
Le camp héberge
des aviateurs et des mécaniciens
espagnols),
demande expresse, ou flagornerie assumée ?
— a choisi l’insigne de l’Armée de l’Air
qu’arbore
Marcel Brenot sur un portrait réalisé par un autre artiste espagnol,
Andrés Tejedén.


Aux musiciens, Marcel Brenot commande aussi l’écriture d’un hymne bien
martial, une marche, paroles et partition pour voix et piano, que
l’orchestre du camp pourra exécuter.
Les musiciens
signent leur œuvre, La marche
du 182e, à la Noël 1941. Elle reprend en titre et en couplet la
devise du Groupe, que n’aurait pas reniée
Baden Powell :
« Toujours prêt ! ». Le parolier allemand, Hans-Julius Schwab, signe un
envoi lyrique : « Je dédie
cette chanson au Commandant Brenot du
182e G.T.E. au Camp de Gurs, mon
chef militaire, et à son groupe, en signe de
ma reconnaissance la plus sentie de notre situation préférée et élevée,
et en signe de ma fierté d’appartenir à un groupe qui est
« Toujours Prêt » à tout ce
qu’il y a de bon et d’utile. »
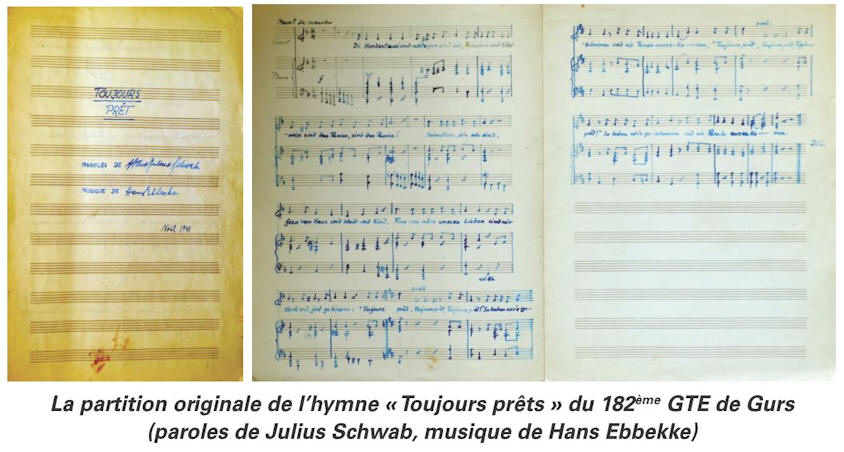
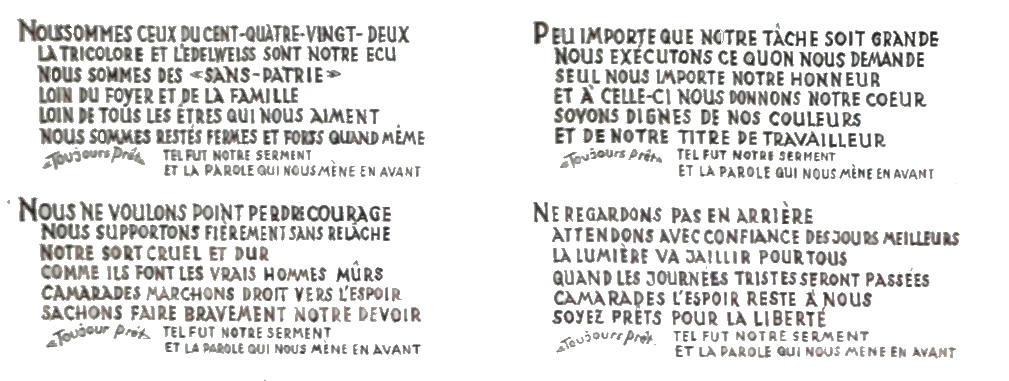
Bon et utile… Le 182e G.T.E. est l’objet de toutes les attentions de l’Organisation Todt. Le 30 juillet 1941, deux sergents recruteurs enrôlent 248 hommes, dont 141 membres du Groupe. Le 3 août, la gendarmerie les escorte jusqu’au Groupement Régional n° 2 de Toulouse (4 rue de Belfort), dont dépendent les 27 G.T.E. du Sud, quelque 13.000 hommes, pour être remis aux Allemand
" L’appel du 526e G.T.E."
En ce Noël 1941, en amenant les couleurs du 182e pour la dernière fois
de l’année, Marcel Brenot fait sensation au camp de Gurs.
Dans un article du « Monde Juif » (N° 153 -
1995), l’historien Christian Eggers, remarque :
« C’est peut-être [le
Commandant de G.T.E.] qui donne l’exemple du plus pur paternalisme de certains « bons chefs »
à l’égard de leurs hommes. »
Soulignant : « Ce même officier
avait (…) fait preuve, dès l’hiver 1941-1942, d’un certain esprit d’opposition, chose rare dans la hiérarchie des camps
à ce moment-là. »
En prononçant
un discours qualifié de « chaleureux » devant les hommes de son Groupe,
Marcel Brenot formule effectivement un vœu assez hardi dans le contexte
de Gurs : « Je souhaite que
1942, déclare-t-il un rien emphatique,
soit pour tous l’année de la Paix… »(
En août
et septembre 1942 seront formés
quatre convois pour les camps d’extermination.)
Dans un brouillon, noirci d’un jet d’une plume ferme, il
écrit puis raye « l’année de la libération ».
Et poursuit : « …dont l’aurore
commence à paraître !… Vive le 182 !! » Le discours, traduit en
allemand et dactylographié, porte la même
correction.
Ces quelques mots, selon Eggers, lui valent d’être éloigné du camp. Son
intransigeance, il a le caractère entier, comme ses exigences
lorsqu’il
s’agit de défendre ses hommes,
lui ont certainement valu quelques solides inimitiés.
Quelques mois après, le 19 mars 1942, Marcel Brenot est affecté au 526e
G.T.E. qu’il
rejoint le 1er avril.
Ainsi
Charles Rivalland (remercié après
un différend
avec le Colonel Lespert, à la tête du Chantier de Jeunesse d’Arudy),
lui cède-t-il
la place le 20 avril.
Le procès-verbal de passage de commandement précise la situation du groupe à cette date. Le 526e Groupe interdépartemental de Travailleurs étrangers chapeaute les autres GTE des Basses-Pyrénées et de la partie des Landes non occupées. A cette date, il compte 777 travailleurs (21 employés par le groupe, 744 détachés chez les employeurs, 4 disponibles et 8 absents). Le 7 mai 1942, le 526e grossit. Les effectifs atteignent 900 hommes « 600 Espagnols, 100 juifs et 200 de nationalités diverses, mais ariens », selon un rapport du Comité d’Assistance aux Réfugiés (C.A.R.) [Cf.26]. L’arrêté des comptes fait apparaître un excédent de 122.573,04 francs (environ 40.500 €). L’encadrement français est composé de six surveillants sous le commandement d’un surveillant-chef.
.
" Un journal franco-espagnol
Le siège du 526e est d’abord à Izeste (tél. : le 5 à Louvie-Juzon). Mais
le Groupe dispose aussi de bureaux à
Oloron-Sainte-Marie,
22 et 25 rue Saint-Grat (tél. : 343), où sont également situés l’écurie
et le garage. Les magasins (ordinaire et matériels) sont au 9 de la
rue Carrerot. Marcel Brenot, précédemment
installé dans un appartement de fonction — un meublé,
18 rue Dalmais, qu’il
loue
à Émile Lucbéreilh, fabricant des pâtes alimentaires « Luc » (marque
déposée) —, investit avec femme et enfants le pavillon dévolu à la
direction du Groupe.
A Izeste, le paysage est somptueux, le jardin à l’arrière de la maison
offre une
pleine vue sur le Pic d’Izeste. Devant, flotte un
étendard sur un mât. Un « dépôt » accueille des T.E. en rupture de
contrat entre deux placements, plus tard doté d’une infirmerie. Dans les
communs, des employés entretiennent une basse-cour et une petite
porcherie d’une dizaine d’animaux moyennement gras. Ils cultivent
également un vaste potager. Une symphonie pastorale dans la fureur de la
guerre. Plus au nord-ouest, à 38 kilomètres à vol d’oiseau
d’Izeste,
au strict opposé d’Oloron, les détenus du camp de Gurs sont en proie à
la famine et aux pires maladies.
Il l’espère
mensuel. Faute de papier disponible chez l’imprimeur
(J.
Lentignac,
à
Oloron.), « Servir » (surtitre « Honneur et Fidélité », la devise de la Légion
Étrangère), tiré à 1.000 exemplaires, ne connaît, semble-t-il, que
quatre parutions (dont une double).
Dans le premier numéro,
daté
du 1er juin 1942, Marcel Brenot annonce : « La
plupart d’entre vous me connaissent comme ancien chef du 182. Vous savez
quelles ont été là-bas [à Gurs]
mes réalisations, dont la
plupart n’étaient qu’à l’état de projet ou d’ébauche, lors de votre
départ. J’ai toujours tenu mes promesses, dans le cadre des lois, et
dans la mesure de mes possibilités (…) »
" Juste, équitable, humain "
Marcel Brenot parle à ses T.E. du 526e G.T.E.
en chef de guerre. Il les exhorte à la patience et à l’engagement. Il
leur explique les difficultés économiques d’une France devenue pauvre,
saignée de ses forces vives, privée de ses hommes prisonniers… Son
projet : disposer de travailleurs d’élite, de
« troupes de choc », de
« groupes d’assaut » sur
le « front du travail »,
dont il entend distinguer les meilleurs par la remise d’un insigne.
Marcel Brenot rappelle ce qu’il
considère
sans doute comme ses victoires contre l’administration :
« J’ai obtenu la suppression de la retenue mensuelle des 60 Fr.
d’habillement depuis le 1er mai. J’ai
également obtenu pour la plupart des T.E. les mêmes droits que les
ouvriers français, en matière d’allocations familiales et d’assurances sociales. »
Il promet :
« Je veillerai à ce que vos femmes et vos enfants ne soient pas dans la
misère. Je pense aux regroupements familiaux (…) » Il assure :
« Je serai juste, équitable,
humain, aussi bien pour les employeurs que pour le T.E.. Toute faute
sera sanctionnée, justement, mais sans faiblesse. »
Dernière
salve, nettement plus comminatoire : « J’interdis d’abandonner le travail, de s’absenter sans en avoir
averti le chef d’équipe chargé d’en demander l’autorisation
au Patron. Il est interdit de rentrer au dépôt à Izeste sans
l’autorisation de l’employeur. Les indésirables seront radiés du 526 et
envoyés dans un groupe spécial. Je ne veux pas de mauvais sujets dans le
mien. »
Mais, à bon entendeur salut : « Les
T.E. seront, par contre, retirés aux mauvais employeurs »…
S’ensuit une liste de courts conseils et de renseignements pratiques, comme ce bref encadré en bas de page, intitulé « Recommandations importantes pour MM. Les employeurs ruraux » : « Pour avoir de bons T.E., fidèles et dévoués, occupez-vous aussi d’eux en dehors du travail. Préoccupez-vous fréquemment du sort de leur famille, de leur femme ou de leurs enfants. Procurez-leur toute l’aide matérielle et morale possible. Ils vous en seront très reconnaissants ».
Les 23, 25 et 27 juillet 1942, la Commission Todt est encore à
pied d’œuvre,
le Mur de l’Atlantique réclame toujours plus de bras pour réaliser ce
projet pharaonique dont Adolf Hitler confiera la supervision au Maréchal
Rommel en décembre 1943 : 15.000 bunkers et blockhaus du Danemark à
la Bidassoa, nécessitant
quelque 13 millions de m3 de béton…
L’occasion pour Marcel Brenot de remercier les T.E.
« pour la ponctualité avec
laquelle [ils se sont] présentés aux Centres de rassemblement. (…) Ceci est la preuve de votre
parfaite discipline ».
« L’appel que je vous adressais dans le premier numéro de
« Servir »
souligne-t-il,
a été entendu. J’ai reçu de nombreuses lettres de
remerciements et d’encouragement. Ceci me confirme dans la résolution de
poursuivre l’envoi de ce bulletin, seul trait d’union entre le Chef et
les membres de notre communauté ».
Dommage, dès la parution de ce n° 2, la traduction en espagnol fait
défaut, pénurie de papier oblige.
" Lutter contre les rumeurs "
Le passage des recruteurs de la Commission Todt a alimenté bien des rumeurs : « Les bruits les plus invraisemblables circulent de bouche à oreille, déplore Marcel Brenot en omettant d’en préciser la nature… Méfiez-vous de ces bobards destinés à créer un état d’énervement néfaste ! Si vous êtes inquiets, n’hésitez pas à écrire pour connaître la vérité. Rejetez toute information qui ne viendrait pas de moi. »
Un appel aux travailleurs espagnols, signé LEMAY, chef
du
Groupement régional
n° 2 (Toulouse), relate sans autre précision de lieu ni de date, qu’ « un attentat a
été commis sur la voie ferrée, au passage du train spécial qui emportait
en Zone occupée 300 travailleurs espagnols volontaires ». S’agit-il des
T.E. recrutés fin juillet ? Y a-t-il eu des morts ou des blessés ? Lemay
demande la participation de tous pour démasquer les coupables et
menace : « (…) Dans le cas
contraire, il n’est pas douteux que les mesures de représailles dont ils
seraient l’objet, auraient pour la totalité d’entre eux, les
conséquences les plus graves. »
Dans cette même livraison, on apprend qu’un « tableau d’honneur des
travailleurs d’élite »
sera publié
dans le numéro 4 du bulletin.
(
« Servir »
n° 5, distribué en décembre 1942, apporte les vœux que Marcel Brenot
adresse aux travailleurs du 526e G.T.E.. Il réitère
les mêmes espoirs que l’année précédente : « Je souhaite que 1943 soit pour vous la dernière année d’exil, et que
vous puissiez rentrer dans vos foyers retrouvés. (…) Pas d’impatience,
la guerre finira, et, alors, vous reprendrez une vie normale auprès des
vôtres. »
" Ce
n’est pas de la délation "
Les Allemands missionnent-ils des « moutons » dans les G.T.E. ? Marcel
Brenot prodigue fermement ses conseils : « Vous
devez particulièrement surveiller les travailleurs arrivant au Groupe en
renfort ; il ne faut pas leur accorder votre confiance totale, avant
d’être sûrs d’eux. Je le répète, vous ne devez pas tolérer d’éléments
malsains parmi vous ; c’est vous-mêmes qui devez procéder
à leur élimination. Les moyens ne manquent pas pour cette opération. (…) Ce n’est pas de la délation, mais de l’autoprotection ;
ils disparaîtront rapidement du Groupe si personne ne veut les
supporter. »
Le Commandant du 526e G.T.E. livre même à ses hommes, ce qu’on appelle
aujourd’hui des éléments de langage :
« Répondez en leur opposant des
réalités tangibles ; vous n’avez que l’embarras du choix : La France vous a accueillis non
comme des prisonniers
mais comme des réfugiés. Vous bénéficiez
des mêmes conditions de travail que les ouvriers français de même catégorie. J’ajoute même que nombreux sont parmi
vous ceux qui, grâce à mes démarches, profitent d’un régime plus
favorable. (…) Vous avez les Assurances sociales, l’Assurance accidents
(…)
[les] Allocations familiales. (…) Vous avez encore lorsque les circonstances
le rendent nécessaire, la sollicitude du Service Social des Étrangers. Vous
êtes soignés dans les hôpitaux français comme les
Français eux-mêmes. (…) Vous bénéficiez
des congés payés, à raison de 12 jours par an. »
Seul bémol : « Vos possibilités de circulation ont été à
peine réduites bien que les agissements coupables de
certains de vos compatriotes aient justifié des mesures beaucoup plus
sévères. »
Marcel Brenot conclut l’énumération par cette réflexion :
« Vous devez être reconnaissant au Gouvernement du
Maréchal de sa mansuétude. » Formule obligée d’un
collaborateur zélé ? Manière de donner le change aux autorités du Camp
de Gurs, qui peuvent parfois douter de l’orthodoxie politique du
Commandant, décidément
très autonome ? Précaution face à l’encadrement du chantier de
jeunesse 31, sans doute vexé de ne pas avoir obtenu gain de cause contre
les T.E. d’Izeste, ne doit pas manquer d’exercer ? (Cf.
22)
La caractérisation
du comportement de Marcel Brenot dans la période 1940-1942 appelle
nombre de nuances.
" L’année de la déconvenue
Cultivé, polyglotte, germanophile,
Marcel Brenot parle allemand couramment depuis la
fin de ses études à Sens et un peu anglais ; conférencier
à ses heures pour ses camarades officiers, grand lecteur féru
d’histoire, Marcel Brenot sait qu’elle ne repasse jamais tout à fait les
mêmes plats.
Il est urgent
d’attendre, de rester debout et de préserver a minima l’ordre qu’exige
toute organisation.
Nourrit-il des sentiments antisémites ? Sûrement non. Mais il ne dit mot des lois scélérates de 1941, encore moins de l’organisation au Camp de Gurs de six convois de détenus emportant vers « une destination inconnue » 3.907 juifs allemands et ressortissants d’autres pays, chargés à même la paille des wagons à bestiaux en gare d’Oloron-Sainte-Marie (Six convois pour Drancy/Auschwitz ont été constitués, les 6, 8, 24 août et 1er septembre 1942, les 27 février et 3 mars 1943).. Ses archives sont muettes sur le déroulement de ces événements tragiques, dont on peut imaginer que l’ampleur et la soudaineté ont dû mobiliser l’essentiel des rouages de l’organisation du Camp (et des deux GT.E. qui en font partie : 182 et 526) et dont il a nécessairement eu connaissance. Rien n’atteste, cependant, que Marcel Brenot a participé d’une quelconque manière à leur préparation ou leur organisation.
 Départ d'un convoi en gare
d'Oloron
Départ d'un convoi en gare
d'Oloron
L’année 1942 marque sans doute un tournant important dans le parcours de
Marcel Brenot et alimente sa déconvenue. Tout menace de partir à
vau-l’eau sous peu dans l’organisation des G.T.E. L’administration de
Vichy ne suit pas. La nourriture est comptée, le matériel vient à
manquer ; comme l’habillement, surtout les chaussures, qui fait
cruellement défaut et l’objet de réclamations incessamment ravivées au
gré des aléas
de la météo.
Ses exhortations à l’ordre et la patience ne sont, chaque jour un peu
plus, que des mots, rien que des mots s’éloignant dangereusement de la
réalité.
" Une fibre sociale
En mai 1942, le rapport d’inspection du Dr Silberstein, responsable du
C.A.R. de Montauban, mandaté par le Comité de Nîmes, qui regroupe à la
demande de Vichy les principales organisations caritatives déployées
dans ou à proximité des camps, note que Marcel Brenot
« (…) s’intéresse beaucoup à ses hommes. (…) Il a
l’intention d’imposer par contrat un salaire mensuel variant entre 375
et 600 frs.
(mais la nourriture et logement en plus à la charge de l’employeur). »
Le Dr Silberstein lui fait
« très respectueusement » (sic) observer
que les employeurs risquent de « se
rattraper »
sur la nourriture des T.E. hébergés chez eux. Argument balayé
d’un revers de main : le Commandant du 526e annonce qu’ « il va déléguer plusieurs
inspecteurs qui vont faire inopinément le contrôle des cantines et, en
plus, il se réserve le droit de faire ce contrôle par lui-même. »
Le Commandant demande une aide financière immédiate pour pouvoir
financer ses projets dont il estime la réalisation urgente : création d’un
foyer
à Izeste, d’une infirmerie d’une dizaine de lits, réorganisation du
service médical…
C’est sur le terrain de l’humanitaire que Marcel Brenot va
nouer des liens avec certaines familles d’Oloron et
de la région, comme avec Henriette Verdalle, fille de Paul Verdalle,
maire et conseiller général de Navarrenx.
Cette dernière apporte un soutien actif aux internés du Camp de Gurs,
parmi lesquels, un avocat berlinois : M. Frederic Wachsner. Marcel
Brenot le dote d’un contrat de travail en bonne et due forme, autorisant
Mme Verdalle à l’employer et l’héberger chez elle à Navarrenx. M.
Wachsner supervisera les études du fils de sa protectrice, André
Laclau-Barrère, né en 1926, avant d’être exfiltré en Espagne, puis de passer à
Londres.
À la Libération, il reviendra en France pour l’épouser.
Le sort heureux du Dr Benedykt Lippa, polonais originaire de
Galicie, T.E. au 182e du camp de Gurs, est à mettre également à l’actif
de Marcel Brenot, qui lui prépare un contrat de travail de complaisance
en juin 1943, afin que le Dr Lippa, une fois sorti du camp, serve de
médecin aux T.E. du 526e d’Oloron. Contrat qui sera honoré après son départ
d’Oloron et du 526e , le 19 juin 1943, par l’un de ses
successeurs, Philippe Grandclément, et son adjoint, Joseph de
Goussencourt, à la date du 26 août 1943.
" Le maximum de ce qu’il était possible de faire "
Dans un mémoire daté de
l’automne 1944,
qui ne mentionne ni les convois ni le nombre de déportés, Marcel Brenot
estime que « le Camp de Gurs a
connu, pendant les années d’occupation,
une notoriété d’un caractère spécialement douloureux. Destiné à recevoir
des étrangers, il a été
le théâtre
de la part de la Gestapo et du gouvernement de Vichy des pires excès. Le
camp comprenait des communistes espagnols, des israélites belges,
allemands, autrichiens, etc., dont beaucoup avaient servi et combattu
dans les rangs de l’armée française. »
Il souligne : « J’ai fait tout
ce qui était humainement possible pour adoucir les rigueurs des ordres
et de la discipline, pour faciliter les évasions, pour sauver de la
déportation de malheureux internés. » « Les mesures prises de ma propre
initiative, poursuit-il,
ont représenté le maximum de ce qu’il était possible de faire étant
donné le contrôle allemand de Vichy. » Et d’énumérer dix points :
« — Déplacement du cantonnement des Travailleurs
[du 182e G.T.E.] à la périphérie du camp.
« — Enlèvement des fils de fer barbelés. Interprétation des circulaires
relatives aux règles de circulation des T.E. dans leur plus large
esprit, même abusif.
« — Autorisation quotidienne de libre sortie pendant plusieurs heures.
Permission de la journée et de 24 heures le dimanche.
« — Permissions exceptionnelles de plusieurs jours pour toute la
Zone Sud (nombreux conflits à ce sujet avec la direction du camp et le
Préfet. Rappel à l’ordre de Vichy).
« — Incorporation au Groupe de nombreux internés du Camp, ex-volontaires
étrangers, dont de nombreux israélites qui, par cette opération,
devenaient Travailleurs libres en bénéficiant immédiatement du statut de
T.E.. J’ai, de cette manière, soustrait d’innombrables anti-hitlériens
de l’Europe centrale à la persécution de la Gestapo et de la police
française.
« Création d’un foyer et d’une cantine, gérés par les Travailleurs, ce
qui a permis de distribuer 300 frs par tête lors de la dissolution du
Groupe.
« Rédaction et signature d’un contrat collectif de travail avec le
Directeur du Camp,
sauvegardant ainsi les droits sociaux de mes hommes.
« Rétablissement du libre exercice du culte israélite et suppression du
travail le samedi. »
En tant que Commandant du 526e G.T.E., Marcel Brenot revendique
l’incorporation de nombreux israélites, ex-volontaires étrangers ainsi
que de réfugiés clandestins cachés chez des particuliers.
« Ceux-ci, précise-t-il,
une fois transformés en T.E., grâce à
un contrat de complaisance, établi par mes soins, contrairement aux
règlements, pouvaient obtenir légalement les cartes d’alimentation, de
textiles, de tabac, et, tout en restant chez leur hôte, acquéraient, de
ce fait, droit de gîte, en échappant, grâce à ma protection et aux renseignements secrets
que je faisais parvenir, à la persécution de la Gestapo, et à la déportation. »
" Les soupçons de Vichy
Le Commandant Brenot organise la protection des T.E.,
« étrangers antinazis
recherchés par la Gestapo ».
Il prépare
« de nombreuses évasions et passages à l’étranger des Travailleurs
recherchés »,
indique des lieux de retraite
« bien qu’étant [lui]-même
surveillé et soupçonné par la police vichyssoise, qui avait connaissance
de [son] activité. »
Plus impliquant encore, il revendique la refonte du fichier du Groupe en
une nuit « pour reculer les dates d’entrée en France de certains Polonais,
Hongrois, Tchèques, Autrichiens, presque tous israélites, pour les
soustraire aux mesures d’internement prévues par Vichy, en reculant leur
date d’entrée en France (avant 1933). »
Un procès-verbal manuscrit en date du 5 mars 1943, atteste que ce jour à
15 heures, Marcel Brenot, assisté par quatre personnes
(Jean
Coulon, Commandant en second (cosignataire), Camille Portier, chef
comptable, Hubert Heinnen, surveillant, Vincente Gandia, employé
du Groupe) a procédé dans les bureaux du 526e G.T.E.
à l’incinération de « 710 ordres de mission, cartes d’identités
de Travailleurs étrangers du Groupe, périmés, remplacés par les
nouvelles revêtues du nouveau cachet »
(sic)
Sur un plan plus politique, dès 1941, Marcel Brenot prend une initiative
remarquée en faveur des Républicains espagnols. On ne lui connaît pas de
sympathies communistes, ce serait plutôt le contraire.
Cherche-t-il à acheter une paix sociale pour calmer les esprits, parfois
vifs à s’échauffer lorsque les privations se font sentir ? Veut-il
conforter sa stature de chef incontestable ? Le 15 avril 1941, bravant
les consignes propres à l’État de siège alors en vigueur, Marcel Brenot,
qui s’est personnellement engagé à ce qu’aucun débordement ne se
produise, organise et préside devant un parterre de 300 ex-miliciens
espagnols, tous du 182e
G.T.E., un grand banquet
à l’hôtel Lubeigt de Navarrenx. Ils célèbrent ensemble le 10e
anniversaire de la seconde République (1931-1939).
Paul Verdalle, le maire, dans un courrier du 27 décembre 1944, atteste
que tout s’est déroulé dans le calme.
« Je voulais ainsi donner à mes
travailleurs, communistes espagnols, une marque de solidarité, laquelle
ne pouvait avoir pour moi que des inconvénients, sans aucune
contrepartie », assurera Marcel Brenot en 1944.
" La coupe est pleine
Peut-il soupçonner à cet instant qu’un certain nombre de travailleurs du
526e
G.T.E., affectés
au chantier de construction de la centrale hydroélectrique de Fabrèges,
dans la vallée d’Ossau, seront bientôt approchés par la Résistance
toulousaine ?
Marcel Brenot a-t-il eu
écho
des infimes prémices
de quelconques mouvements
précurseurs ? Les documents qu’il a laissés ne permettent pas de le
supposer.
Les exigences allemandes depuis l’invasion de la Zone libre, auxquelles
s’ajoutent les pressions et les projets de l’Organisation Todt sur les
G.T.E. et particulièrement en mai 1943 concernant le 526e ; un incident
notable avec un employeur dépité d’avoir perdu un Travailleur qu’il
appréciait ;
les lourdeurs de l’administration de Vichy ; la complexité
des relations avec les représentants de diverses institutions, dont les
ressorts répondent
à de subtils et obscurs rapports de forces… tout finit par convaincre
Marcel Brenot qu’il est temps de partir.
Il démissionne
du 526e G.T.E. fin mai 1943,
avec effet au 20 juin. Le 19, il passe officiellement son commandement à
François Bodin-Hulin, son second
qui contresigne des comptes tirés au cordeau.
Le solde de caisse est créditeur de 185.575 frs. Le 526e compte 822
travailleurs : 21 au service du Groupe entre Izeste et Oloron, 773
placés chez les employeurs de la région, 17 malades, 7 absents, 2
permissionnaires et 4 disponibles.
Après deux ans et huit mois passés dans les Basses-Pyrénées, Marcel Brenot est nommé Commandant régional des Groupes Mobiles de Réserve (G.M.R.) à Orléans.
( En 1944 Marcel Brenot écrit : « J’ai accepté le poste de Commandant Régional [des G.M.R.] à Orléans sur les instances du Commandant Robelin [Chef d’Escadron, sous-directeur technique de la Garde, dirigée par le Général Perré, à Vichy], torturé avant la libération de Vichy par la Gestapo, et mort de ses tortures, pour avoir été membre de la Résistance.»).
Il prend ses fonctions en juin 1943 avec le grade de Colonel
après deux stages organisés à l'Ecole de police d'Aincourt.
« À cette époque, il s’agissait uniquement de la formation d’éléments de
police militarisés devant camoufler, aux dires du Cdt Robelin, les
embryons d’une future armée de la Libération. »
Pour ses années pyrénéennes, il reçoit un certificat de travail agrémenté de l’appréciation suivante : « Monsieur Brenot a toujours fait preuve d’un grand esprit de discipline et de beaucoup de zèle et d’initiative dans l’exercice de ses fonctions qu’il a quittées, de son propre gré, pour occuper une situation plus avantageuse qui lui était offerte. »