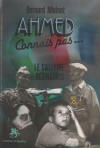Les G.M.S.
GROUPES MOBILES DE SECURITE
Unités Supplétives parmi d'autres en Algérie 1955-1962.









Par le Colonel Jean LAROCHE.
Commandant de Groupement honoraire, des G.M.S.

L'un des 114 fanions.
Sur décision gouvernementale, les G.M.S. sont créés le 24 janvier 1955 par arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie, M. Roger LEONARD sous le sigle initial de : Groupes Mobiles de Police Rurale (G.M.P.R.). Ils deviennent Groupe Mobiles de Sécurité (G.M.S.)
en 1958 (arrêté du 25 juillet, signé Robert LACOSTE).
Leur raison d'être tient au constat, dès les premiers mois de la rébellion, du manque dans les zones rurales de forces adaptées aux tâches multiples et variées qu'impose la police du "bled". Pour remédier à cette situation, rendue vite alarmante par l'insécurité grandissante, il est donc décidé de mettre sur pied une force de police rurale à caractère spécifiquement algérien et de l'implanter aux points les plus éloignés des centres de commandement habituels, là où justement l'insuffisance des moyens traditionnels est la plus marquée.
L'idée conceptrice répond en outre au souci d'associer la population à l'œuvre projetée de sécurité. Elle se veut aussi, au travers de cette police de proximité, promesse d'avenir en affichant la volonté d'une mission rurale dans la durée. Cette détermination se traduit par le statut original, inédit, de cette force de police civile, relevant de l'autorité civile, le Directeur de la Sûreté Nationale en Algérie.
C'est celui-ci qui, par procuration du Délégué Général du Gouvernement en Algérie; exerce son autorité par le biais d'une Délégation Centrale des G.M.S. créée dans ce but.
Le recrutement cible les Français de souche locale, volontaires, anciens militaires, anciens combattants. L'encadrement se recrute plus spécialement auprès de Français de souche européenne, officiers et sous-officiers de réserve ou issus de l'armée d'activé. Le Groupe (unité de base) est une unité mobile dotée d'un armement et d'un matériel léger du type compagnie d'infanterie. Quelques-uns sont dotés d'un peloton monté. L'effectif théorique est de 95 : 2 officiers - 8 sous-officiers-13 petits gradés-72 gardes. La solde est égale à celle afférente au grade détenu en vigueur dans l’armée.
Les débuts sont pleins d’improvisation et reposent sur l’énergie des premiers « aventuriers ». Image de la pénurie, les cavaliers sont « invités » à rejoindre avec « cheval convenable et harnachement suffisant ».
L’image provoque scepticisme parmi les militaires et les autorités. Et pourtant l’entreprise va prospérer. Prévus au titre du premier objectif, à 54 groupes, les GMS sont au nombre de 100 au 1er juillet 1960 et de 114 à la date de leur dissolution en juillet 1962 : Région d'Alger, 36 ; Région d'Oran, 30 ; Région de Constantine, 48. Le métier proposé plaît : ne voit-on pas quatre sous-lieutenants du 8° RIC (Oranie), adopter successivement le képi bleu GMS dès la fin de leurs obligations militaires ou d'engagements.
Compte tenu des troubles, les GMS sont mis pour emploi à la disposition de l'autorité militaire pour l'exécution des missions opérationnelles et territoriales. Ils se voient confier la responsabilité de sous-quartiers. L'effort accompli, les preuves d'efficacité données, les résultats obtenus se concrétisent par un arrêté du 29 juillet 1958 qui, outre l'adoption du signe G.M.S., donne plein statut aux personnels. Pour consolider le dispositif, à cela s'ajoute la mise en œuvre d'un plan de construction de cités-cantonnements afin de fixer les implantations définitives, de regrouper les familles et de former des centres de rayonnement sur lesquels s'appuieront le rôle moral et social en direction de la population. Telle était l'ambition promise à l'Algérie redevenue sereine par ce programme inscrit au cœur du Plan de Constantine. Pour assurer en parallèle, la qualité du recrutement, une Ecole de Police GMS était créée en 1961 à Hussein-Dey (banlieue d'Alger) ouverte aux élèves officiers et aux élèves sous-officiers. Le prix G.M.S. pour atteindre cette ambition de résultats s'est élevé à 734 tués au combat, dont 32 officiers et 52 sous-officiers, 1300 blessés graves, 2000 titres de guerre glanés dont 88 Légions d'Honneur et 150 Médailles Militaires. En d'autres chiffres, le nombre de tués, c'est 7 % de l'effectif constant sous armes, c'est 25 % des pertes totales subies par les unités supplétives en Algérie.
L'œuvre était ambitieuse, la désillusion cruelle. Ce furent tout d'abord les accords d'Evian et le cessez-le-feu. En application, les G.M.S. sont versés dans la Force Locale. Rien ne bouge, en apparence, au sein des Groupes. Il n'en n'est pas de même dans les têtes : le fracas des villes, les missions "perverses" telle la garde de Radio Alger, l'attitude environnante, les nouvelles parvenant des familles, font pression forte voire insoutenable. Cependant, à l'exception de quelques démissions ou désertions dans l'ordre des choses, l'unité des Groupes perdure jusqu'en juillet 1962, le respect rendu aux cadres est toujours référence appliquée. Ce fût ensuite l'indépendance, le séisme. En peu de jours tout bascule. Les GMS sont dissous ; quelques violences internes...l'encadrement est rapatrié sur la Métropole. C'est l'abandon. La nouvelle autorité algérienne prend possession des Groupes. Seuls 2000 gardes sont extraits du piège et embarqués sur initiatives individuelles, en ignorant les directives reçues et grâce à l'aide d'hommes dignes, civils et militaires. Les autres, plus de 8000, subissent le sort connu de tous les supplétifs, martyrisés, assassinés sur place ou dès leur arrivée dans leur village. Les matériels, armement, véhicules sont politiquement remis au F.L.N.
Quelques neutralisations, mises hors fonctionnement, récupérations ; les drapeaux amenés, les fanions cachés dans les cantines ; c'est peu...mais c'est réellement tout. Ainsi se disperse, ainsi se termine, ainsi s'engloutit la courte histoire des G.M.S. en Algérie, forts de 10.000 combattants volontaires musulmans, arabes et berbères, constituant avec leur famille, une communauté de 70 000 personnes n'ayant d'autre conception morale que la France. La "dégringolade" n'est pourtant pas achevée pour les 2 000 gardes récupérés. Ils connaissent l'humiliation des centres de regroupement, le parcours chaotique de la communauté harkie... Pour les quelques 650 officiers et sous-officiers, le sort est plus clément. Affectés à leur retour, au Ministère de l'Intérieur, Service National de la Protection Civile, constitués en "Corps d'extinction", répartis par petits paquets dans les préfectures ou en Centrale, ils bâtissent les fondations, pour une large part de la Sécurité Civile. Il s'agit d'une autre histoire, d'ailleurs curieusement occultée comme leur première vie.
Aujourd'hui, les 180 vétérans encore debout, réunis en association interviennent par fidélité à leur passé, pour l'honneur de leurs morts au combat et pour celui du plus grand nombre laissé en chemin.
Texte adressé par M. Marcel CADEO de l'Association Nationale des Personnels des Groupes Mobiles de Sécurité.
Le GMPR n°3 sur le site "Images Défense"
Quelques documents sur les GMPR et GMS
( https://www.histoire-et-philatelie.fr/ >> visite conseillée)
**********